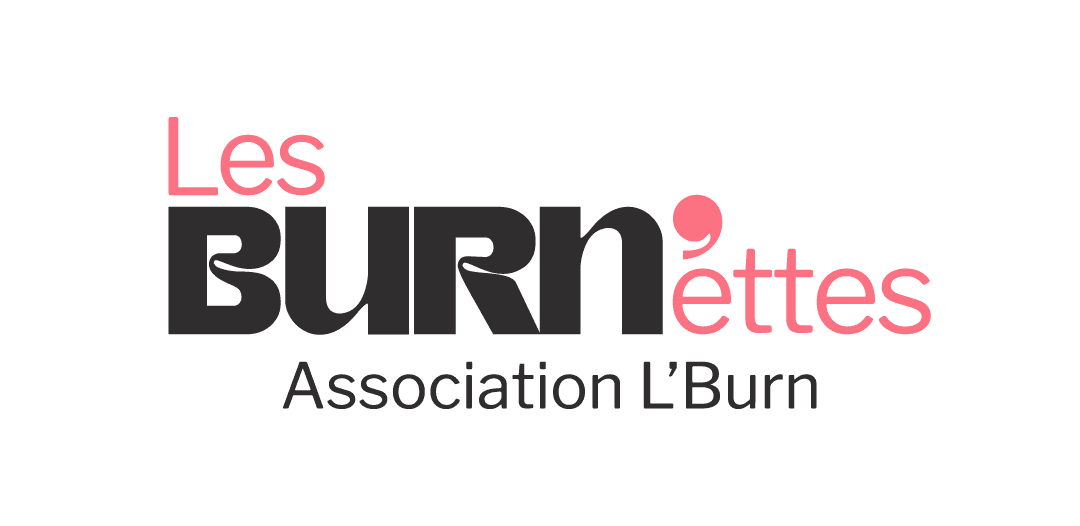Catherine Mieg est psychanalyste depuis 10 ans. Dans une autre vie, elle a été assistante sociale en entreprise, a travaillé à la direction générale de l’ANPE, a été consultante dans un cabinet de RH. “J’ai attrapé le travail par des tas de biais différents !”, nous prévient-elle. Elle consulte depuis maintenant 10 ans, et reçoit plus spécialement des salariés en souffrance. A côté de ça, elle est consultante en management, accompagne des cadres dans leur pratique. Elle sort ce mardi 2 mai un livre, “J’ai mal au travail, parcours en quête de sens“, aux éditions François-Bourin, qui, à travers des récits de prise en charge, essaye de décrypter l’impact des activités professionnelles sur la santé mentale. L’idée : donner des clés au salarié, mais aussi au manager et au soignant, pour mieux accompagner la souffrance au travail et les effets sur la santé. Entretien.
Les environnements de travail se sont quand même bien dégradés, du fait de ce management très orienté vers l’individualisation, qui a cassé le collectif, qui a mis les gens en concurrence, ce qui est contre-intuitif par rapport à la façon dont le travail se réalise vraiment.
Autre problème : autrefois, le travail était généré par des gens du métier. Maintenant ce sont des gestionnaires qui ont pris la main et qui gèrent, par des chiffres, des tableaux de bord, des systèmes informatiques de suivi d’activité, sans avoir demandé aux gens ‘mais comment travaillez-vous réellement ?’. On met sur les épaules salariés des procédures qui les gênent pour travailler, qui leur font perdre un temps fou, et qui en plus ne vont être analysées par personne derrière. Du coup, on a perdu le contact avec le travail réel, le côté vivant du travail : il est devenu complètement normé, stérile. Ou plutôt il est pensé de manière tellement normée, qu’il empêche toute marge de manœuvre. On a perdu la créativité des gens, leur initiative, leur autonomie, leur motivation, tout ce qui fait que les gens sont bien au travail !
Il y a aussi le capitalisme financier qui sévit de plus en plus, dans un très court terme. On ne laisse plus aux gens le temps d’apprendre, de découvrir un environnement, d’essayer de nouvelles manières de faire. Il faut un retour sur investissement immédiat, et ce court-termisme est une catastrophe. On ne parle de la valeur ajoutée que comme… financière. On oublie qu’il y a aussi dans le travail une valeur ajoutée immatérielle, qui est l’épanouissement, la solidarité, le plaisir de faire ensemble, l’expérience qu’on va développer au fur et à mesure et qui va devenir une sorte de capital.
La manière dont la personne investit le travail est liée très fortement à sa structure de personnalité, à ce qu’elle a connu, au modèle dans lequel elle a grandi. Nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Si vous avez grandi avec un père qui vous a dit qu’il faut énormément travailler car c’est comme ça qu’on peut s’en sortir dans la vie, ou que vous avez collé aux désirs des parents pour choisir la voie dans laquelle ils voudraient que vous vous épanouissiez, vous n’investirez pas le travail de la même façon.
Elles sont en fait multifactorielles. Quand je vois un patient arriver en burn-out, je décortique avec lui ce qu’il s’est passé, et le point de rupture. J’essaie de le qualifier avec eux : est-ce la surcharge, le déficit de reconnaissance, la souffrance éthique ou l’isolement ? Un burn-out, c’est extrêmement violent, les gens oublient tout, n’arrivent plus à se concentrer voire même à se lever. Ils ont l’impression de devenir fou. Réussir à mettre des mots illustrant les causes, c’est déjà structurant : cela permet de penser leur situation, de n’être plus dans l’émotion, de prendre du recul, et se déprendre du traumatisme dans lequel ils sont.
C’est un concept relativement récent, dont on ne parlait pas il y a 5 ans. La souffrance éthique, elle est dans le conflit de valeurs, entre l’idéal du métier que se font les gens, et ce que va leur demander l’entreprise. Aujourd’hui, la rentabilité est placée en premier, la pression est mise sur la productivité, la qualité devient le parent pauvre. Les salariés voient qu’ils sortent des produits qui ne sont pas de qualité, ou ils ne peuvent pas bien accompagner des gens qui vont mal, et ils en sont malades ! Cela peut-être par exemple une assistante sociale à qui l’on va demander de recevoir 5 personnes dans la matinée, et qui considère que son objectif de qualité est que le bénéficiaire aille mieux, et qu’elle ne va pas avoir assez de temps. Autre exemple qui me vient : l’autre jour, j’étais dans une caisse de retraite, et la personne qui faisait l’entretien ne cessait de dire “il reste 5 minutes”, “il reste 5 minutes”. Au lieu d’être disponible pour l’entretien, il était bloqué par cette règle. C’est vraiment mettre des pressions qui ne servent à rien, si ce n’est gâcher le sens et l’investissement de la personne. On trouve souvent un conflit de valeur à un moment dans les burn-out.
Il y a trois destins à la souffrance au travail. De base, le travail, ce sont des aléas, des problèmes à gérer. Vous puisez dans vos ressources, et quand cela se passe bien, cela devient du plaisir, vous êtes fier de ce que vous avez fait. On est du côté de la spirale de la santé, et de l’épanouissement de la personne. Deuxième scénario : cela commence à dysfonctionner. Vous arrivez encore à vous débrouiller, mais vous faites face à des orientations qui changent tous les quatre matins, de plus en plus de soucis, vous êtes épuisé car deux postes ont été supprimés et vous faites le travail de 4 personnes… C’est le scénario intermédiaire : les gens commencent à se désinvestir du travail. Les mécanismes de défense vont être de dire : je me mets en repli, je pars plus tôt, j’en fais moins. Mais d’autres, à l’inverse, vont travailler encore plus, à la fois pour assurer, et comme aussi s’ils se saoulaient au travail, pour ne plus penser. Et à un moment, ça craque. En fait, c’est plutôt une bonne nouvelle : votre inconscient vous dit stop, votre corps aussi. Cela vous sauve.
Je ne pense pas. Si cela fait sens pour eux, par leur travail, il n’y aura pas de résistance au changement. En fait, il faut trois choses pour que les gens se sentent bien dans leur travail : qu’ils aient l’impression que c’est utile, qu’on leur donne les moyens de bien travailler et enfin, la reconnaissance. Ce dernier point, c’est le maillon qui va permettre de transformer tous les efforts que je fais en plaisir et en épanouissement. Quand il y a ces trois choses, la surcharge n’est plus un problème : on le voit bien, quand il y a un coup de bourre à donner, les gens peuvent avoir une résistance incroyable. Ils arrivent tous en burn-out ici en disant que c’est dû à la surcharge de travail, mais quand on décortique, ce n’est pas forcément cela qui les a fait en réalité plonger.
Je crois qu’il y a vraiment quelque chose à faire du côté managérial, que les managers soient avertis, via les Sciences du travail, de ce que le travail produit sur l’être humain, et ce qu’il en attend. Il y a un vrai déficit à ce niveau-là. Mais il y a quand même un mouvement de réflexion autour du monde du travail qui s’entame, en se disant qu’on ne va pas pouvoir continuer comme ça et qu’on est en train de scier la branche sur laquelle on est. Mais ce fonctionnement tient aussi d’une idéologie néo-libérale, des croyances dont il ne va pas être facile de sortir : par exemple, l’évaluation, ça ne sert à rien. Si vous donnez aux gens les moyens de bien travailler, ils vont faire leur boulot. Leur mettre la pression, ou même des primes, cela n’a pas de sens ! Mais si vous supprimez cela, les managers auront l’impression de ne pas être présent auprès de leurs équipes.
La seule solution, c’est le collectif ! Des collectifs qui soient capables de réagir ensemble, de discuter de comment ils travaillent, de réagir par rapport à leurs managers. On est fort en collectif ! Mais tout est pensé en silos dans l’entreprise, pour casser les collectifs. Il ne faut pas tomber dans le piège, il faut continuer à réfléchir à ce qu’il se passe, se trouver des alliés et oser dire non.